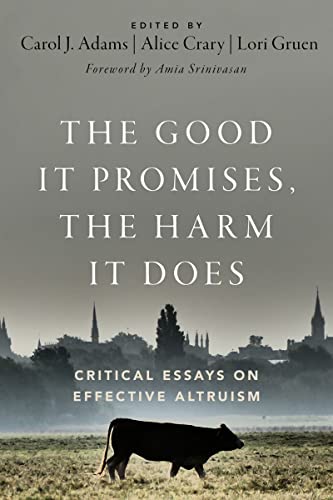The Good It Promises, The Harm It Does.
Critical Essays on Effective Altruism,
de Carol J. Adams, Alice Crary et Lori Gruen (dir.),
Oxford University Press, 2023.
Le monde est confronté à de nombreux problèmes : faim, maladie, pauvreté, violence, risque d’épidémie, etc. On peut avoir le désir d’aider. Mais que faire ? Une première réponse consiste à dire que l’important est de donner de l’argent ou de s’investir personnellement pour la cause qui nous touche le plus. Toutefois, à la fin des années 2000 est né un mouvement, appelé altruisme efficace, qui préconise, avant d’agir, de déterminer rationnellement et de manière impartiale quel mode d’action à notre disposition aura le plus grand impact positif. Plutôt que de donner à un organisme qui, spontanément, nous plaît, il vaudrait ainsi mieux évaluer au préalable l’efficacité relative de ce genre d’organisme et choisir celui qui a le meilleur retour sur investissement ; par exemple, celui qui sauve le plus de vies pour la même quantité d’argent. Avec cette rationalité au service de la charité, ce mouvement s’est rapidement développé ces dernières années et dispose maintenant de millions de dollars qu’il redistribue vers les actions qui lui semblent avoir le plus fort impact pour améliorer le monde.
Mais, comme en témoigne ce livre collectif, l’altruisme efficace est aussi la cible de nombreuses critiques. Le reproche principal que lui adressent ses adversaires est que, derrière sa promesse d’œuvrer pour un monde meilleur, il ne ferait implicitement que nous inciter à accepter le monde tel qu’il est. En particulier, à travers ses évaluations froides et quantitatives, il encouragerait le soutien à une économie de marché qui, dans de nombreux cas, selon ces critiques, serait responsable des maux auxquels il prétend s’attaquer. Autrement dit, l’altruisme efficace favoriserait des stratégies d’ajustement qui contribueraient à la persistance de systèmes jugés nuisibles. De la même manière, par son approche uniquement comptable, il aurait tendance à ne pas écouter les acteurs de terrain et même les victimes qu’il prétend aider. Il serait donc sourd à des démarches que d’aucuns jugent plus prometteuses.
Ces critiques sont-elles justifiées ? C’est à voir. Ce qui est sûr c’est qu’un mouvement qui se fonde sur la rationalité ne peut que bénéficier de ces remises en cause pour réfléchir à ses principes et à ses modes d’action et, au final, pour tenter de s’améliorer.
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
358, mai 2023.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr.