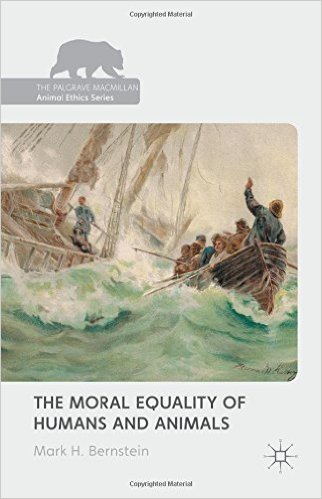The Moral Equality of Humans and Animals,
de Mark Bernstein,
Plagrave Macmillan, 2015.
Un chien a-t-il autant de valeur morale qu’un être humain ? Dans la plupart des débats autour du véganisme, cette question n’est pas fondamentale. En toute logique, il suffit de remarquer que les animaux ont une valeur morale pour montrer que presque toutes les activités humaines reposant sur leur exploitation sont illégitimes. Par exemple, même si on considère que les intérêts d’un être humain passent avant ceux d’un animal, il n’est pas pour autant légitime de tuer ce dernier juste pour avoir le plaisir de le manger. Cela dit, les personnes qui exploitent les animaux tentent souvent de se justifier en prétextant que ces derniers ont moins de valeur morale que les êtres humains. D’où l’intérêt de régler cette question, comme s’engage à le faire dans ce livre le philosophe étatsunien Mark Bernstein.
Derrière la thèse de la supériorité morale des êtres humains, Bernstein décèle deux idées distinctes. Premièrement, celle qui stipule que les intérêts des êtres humains méritent davantage de considération que ceux des animaux. S’il fallait choisir entre soigner un chien ou un être humain atteints des mêmes maux, il faudrait ainsi privilégier l’intérêt du second à ne pas souffrir. La deuxième idée stipule que la vie des êtres humains a plus de valeur que celle des animaux. S’il n’était pas possible de sauver à la fois un chien et un être humain en train de se noyer, il faudrait sauver le second. Toute la question est donc de savoir si ces deux idées peuvent se justifier.
Commençons par la première. Pourquoi devrait-on accorder davantage de considération aux intérêts des humains ? Pour être impartial, Bernstein nous invite à imaginer qu’un extraterrestre débarque sur Terre et découvre un humain et un chien souffrant de la même maladie. Malheureusement, ce visiteur n’a amené avec lui qu’une dose du médicament qui peut les soigner. Pourquoi le donnerait-il à l’humain plutôt qu’au chien ? Les défenseurs de la supériorité humaine diront que c’est parce que le premier possède des attributs, par exemple la rationalité, dont le second est dépourvu. L’exclusivité de cet attribut étant plus que discutable, Bernstein critique cette approche en faisant appel à l’objection classique des cas marginaux. Étant donné que des animaux font preuve de plus de rationalité que les jeunes enfants et certaines personnes handicapées, les défenseurs de la supériorité humaine devraient admettre que les intérêts des premiers méritent plus de considération que ceux des seconds. Ce qui contredirait leur thèse. De toute façon, même en acceptant l’hypothèse d’une absence de rationalité chez les animaux, il est possible selon Bernstein de développer une autre objection à cette approche qui peut se résumer de la façon suivante. Si la rationalité est ce qui justifie une plus grande considération envers les intérêts des humains, que faire face à deux humains qui n’ont pas le même degré de rationalité ? Faut-il soigner le plus rationnel avant celui qui l’est moins, voire très peu ? Soigner Albert Einstein plutôt que tel ou tel enfant, par exemple ! Cette option n’étant pas acceptable, il faut en déduire que c’est la rationalité en elle-même et non le degré de rationalité qui doit être pris en compte. Mais, dans ce cas, privilégier un humain possédant un degré infinitésimal de rationalité par rapport à un chien censé ne pas en posséder apparaîtrait arbitraire, comme l’est de toute façon le choix de cet attribut. Pourquoi en effet ne pas privilégier la pilosité, la résistance au froid ou la disposition à la fidélité ? Bref, pour Bernstein, il paraît douteux qu’un extraterrestre privilégie systématiquement l’humain par rapport au chien.
Peut-on s’en sortir en adoptant une approche plus partiale ? Notre statut d’humain ne pourrait-il pas servir à légitimer le privilège accordé aux intérêts des membres de notre propre espèce ? Il se pourrait même que ce biais en faveur de sa propre espèce s’explique par la théorie darwinienne de l’évolution. Le problème est qu’un fondement « naturel » à un comportement ne vaut pas justification. Comme le fait remarquer Bernstein, si les hommes avaient tendance, pour des raisons évolutives, à être violents à l’encontre des femmes, cette disposition « naturelle » ne rendrait en rien leur violence légitime. Pour rester dans l’approche partiale, on pourrait également avancer que, de la même manière que l’on a plus de loyauté envers les membres de sa propre famille qu’envers ceux d’une autre famille, il serait normal de privilégier les membres de sa propre espèce. Pourtant, la loyauté s’étend rarement au-delà d’un cercle restreint de ses compatriotes, dans lequel figurent parfois des animaux. Par exemple, beaucoup de personnes seraient plus loyales envers leur chien qu’envers un inconnu. Voilà qui indique que même l’appartenance à l’espèce humaine ne permet pas de justifier qu’il faille accorder davantage de considération aux intérêts des êtres humains. Ce premier résultat permet à Bernstein d’en venir à la deuxième idée derrière la thèse de la supériorité morale des humains.
La justification la plus souvent avancée à l’idée que la vie des animaux a moins de valeur que celle des humains est que les premiers auraient moins à perdre en mourant. Ayant un sens du futur plus limité, élaborant moins de projets ou des projets à plus court terme, et vivant davantage dans le présent que les humains, les animaux ne verraient pas leurs attentes autant brisées en cas de mort prématurée. Du coup, il serait moins grave de les tuer. Là encore, pour Bernstein, cette justification n’est pas valable. D’abord, si elle était pertinente, elle impliquerait qu’il serait d’autant moins grave de tuer un humain que celui-ci ferait peu de projets. Inutile de dire que toute idée de justice et d’égalité s’en trouverait fortement bousculée. Ensuite, il y a encore le problème des cas marginaux. Certaines personnes handicapées et les enfants en très bas âge ne se projettent pas dans un futur très lointain ; parfois, pas plus que certains animaux. Leur vie aurait-elle pour autant moins de valeur que celle de ces derniers ? Il y a aussi le fait que cette capacité à se projeter dans le futur a pour corollaire l’insatisfaction provenant des projets, rêves et désirs non réalisés. Comment donc peut-on considérer que mettre un terme à une vie humaine pleine de frustrations puisse être plus grave que stopper la vie d’un animal épanoui au jour le jour ? N’est-il pas plus dommageable de priver le second d’un futur riche en satisfactions que d’abréger la longue suite de déceptions du premier ? Enfin, rien ne dit qu’une vie qui se construit sur des projets futurs à plus de valeur qu’une vie qui est investie dans le moment présent : non seulement l’échec des projets peut nuire à la qualité de la vie mais, à force de se projeter dans le futur, celle-ci peut perdre en intensité.
De toute façon, Bernstein trouve problématique de chercher à déterminer la valeur d’une vie à partir d’une capacité, ici celle à se projeter dans un avenir lointain. D’abord, il ne saurait être question de prendre en compte la capacité en elle-même. Sinon, la vie d’une personne qui formule plein de projets et celle d’une autre personne qui, bien qu’elle ait aussi cette capacité, préfère vivre au jour le jour auraient toutes deux une valeur identique. Dans ce contexte, cette conclusion serait absurde puisque le nombre et la richesse des projets étaient ce qui devait servir à distinguer leur valeur. Il faut donc que ce soit l’usage de la capacité qui soit pris en compte et non la capacité en elle-même. À partir de cette mise au point, il faudrait considérer qu’une vie aurait plus de valeur qu’une autre si elle comportait davantage de projets ou d’attentes réalisés. Autrement dit, ce serait la satisfaction que l’on éprouve à voir se réaliser ses projets et attentes qui ferait la valeur d’une vie. Or rien ne dit qu’un animal qui n’a pas cette capacité n’est pas en mesure d’avoir autant de satisfactions, si ce n’est davantage. Du coup, comment la possession d’une capacité pourrait-elle servir à déterminer la valeur d’une vie ?
Enfin, Bernstein trouve quelque peu cocasse que, pour défendre la supériorité de la valeur de la vie humaine, il faille évaluer ce que l’on perd en mourant. Ne faudrait-il pas mieux apprécier ce que la vie vaut en elle-même, quand on est encore en vie ? Dans ce cas, qu’est-ce qui ferait que, à un moment donné, la vie d’un être humain aurait plus de valeur que celle d’un chien ? En général, les tentatives pour justifier cette supériorité se ramènent à dire que les humains ont accès à des satisfactions « supérieures », liées aux plaisirs intellectuels (écouter de la musique, lire de la poésie, résoudre un problème de mathématique, etc.), alors que les animaux seraient limités à des satisfactions « inférieures », liées aux activités corporelles (manger, avoir des relations sexuelles, bouger, etc.). Mais pourquoi attribuer moins de valeur à la richesse de la vie sensorielle d’un chien qu’à celle de la vie intellectuelle d’un être humain ? N’est-il pas arbitraire de décréter que les satisfactions liées aux activités humaines témoignent d’une plus grande valeur morale que celles liées aux activités « animales », que d’ailleurs les êtres humains poursuivent avec grand appétit ? En somme, ne serait-ce pas simplement notre humanité qui nous inciterait, de manière biaisée, à penser qu’il vaut mieux vivre en tant qu’être humain plutôt que sous une forme animale ?
Voilà brièvement esquissé la trame des réflexions qui conduisent Bernstein à rejeter la thèse stipulant que la vie d’un animal à moins de valeur morale que celle d’un être humain. Pour chaque ligne de pensée, les arguments sont pesés, sous pesés, et repesés de sorte que le livre met clairement la charge de la preuve du côté de ceux qui voudraient encore défendre cette thèse.
Thomas Lepeltier, Versus, printemps-été 2016.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr