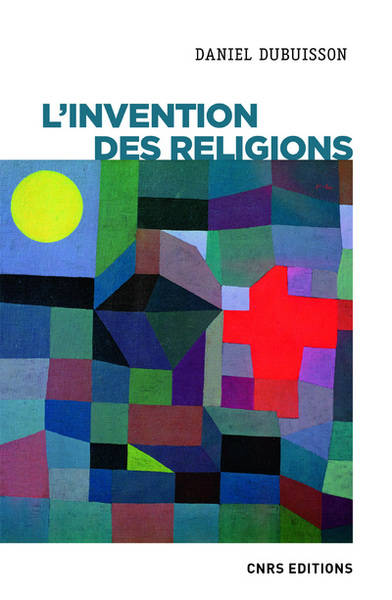L’Invention des religions.
Impérialisme cognitif et violence épistémique,
de Daniel Dubuisson,
CNRS Éditions, 2020.
L’idée que la religion est un phénomène universel serait une invention de l’Occident chrétien. À partir du xixe siècle, avec le développement de chaires universitaires en études religieuses, les savants européens auraient en effet appréhendé les autres cultures à travers la grille de lecture qui leur servait à penser leur propre société, structurée par le christianisme. Les autres formes de croyances et de rituels auraient donc été perçues, à l’instar de ce dernier, comme faisant partie d’un tout, appelé religion. Les sociétés où ces aspects étaient moins unifiés et codifiés que dans la religion chrétienne étaient juste vues comme étant restées à un stade plus ou moins primitif de la religion. Mais toutes ces sociétés possédaient bien une religion, pensait-on. En ce sens, l’histoire des religions, en tant que champ de recherche, aurait inventé l’objet qu’elle se proposait d’étudier. C’est du moins la thèse que défend ici Daniel Dubuisson.
Sa démarche s’inscrit dans un renouveau de l’histoire des religions, à la fois critique à l’égard des présupposés de la discipline et attentif à la spécificité des autres cultures, où croyances et rituels ne sont pas nécessairement liés comme dans la religion chrétienne. Par exemple, dans la Rome antique, des rituels pouvaient être rigoureusement respectés, alors même que la société ne connaissait ni révélation, ni dogme, ni orthodoxie. Souligner ainsi la dimension chrétienne du concept de religion ne veut pas, pour autant, dire qu’il ne s’applique qu’au christianisme. Comme le montre Dubuisson, l’hindouisme et shintoïsme sont aussi des religions, au sens où le christianisme en est une, mais uniquement depuis le xixe siècle, lorsqu’un ensemble de croyances et de rituels disparates ont été unifiés par ceux-là mêmes qui venaient les étudier.
Inutile de dire que cette situation peut sembler cocasse puisque, en déconstruisant le concept de religion, les spécialistes des religions perdent le concept même auquel sont censés se rattacher les différents phénomènes qu’ils étudient. Mais ce regard corrosif rend la démarche très stimulante…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
333, février 2021.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
ou Place
des libraires.