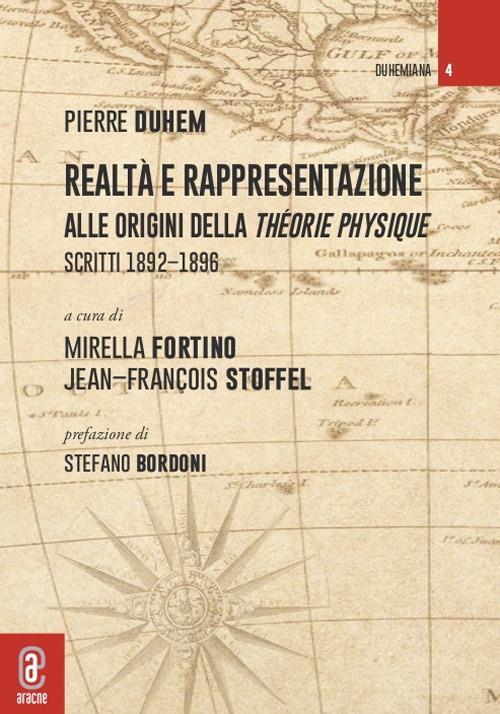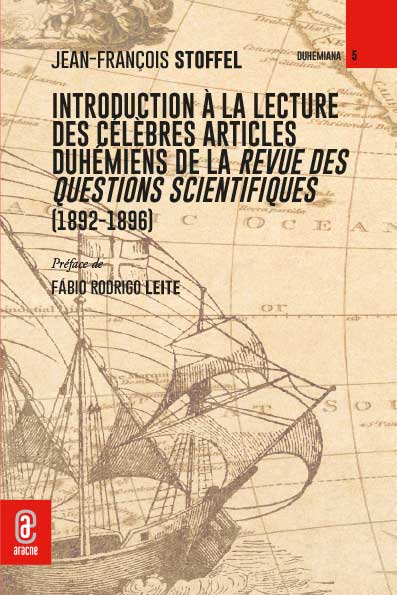Realtà e rappresentazione.
Alle origini della Théorie physique. Scritti 1892-1896,
de Pierre Duhem,
Aracne, 2022.
Introduction à la lecture des célèbres articles duhémiens
de la Revue des questions scientifiques (1892-1896),
de Jean-François Stoffel,
Aracne, 2022.
Quelle relation y a-t-il entre la physique et la métaphysique ? Sur cette question et bien d’autres concernant la philosophie et l’histoire des sciences, l’oeuvre de Pierre Duhem (1861-1916) est fondamentale. En général, les connaisseurs ont lu ses ouvrages L’évolution de la mécanique (1903), La théorie physique (1906) et Sozein ta Phainomena (1908). Les plus courageux ont même abordé son monumental Système du monde (1913-1959). Mais ils connaissent peu ou pas les textes qui précèdent ces travaux, en particulier les articles que Duhem publia entre 1892 et 1896 dans la Revue des questions scientifiques. Ces articles apportent pourtant un éclairage important sur la mise en place des idées de Duhem et leur contexte d’élaboration. D’où la bonne idée de les rassembler en un volume, qui plus est avec une traduction en italien. L’ensemble est accompagné d’une introduction, qui présente à la fois les textes et les débats qu’ils ont suscités. Elle forme un ouvrage à part et a été écrite par un des meilleurs spécialistes de Duhem, Jean-François Stoffel, à qui on doit l’excellent livre Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem (2002). Les deux ouvrages sont publiés chez un éditeur italien.
En 1892, avec la publication de « Quelques réflexions au sujet des théories physiques », Duhem, qui n’a publié que des ouvrages de physique théorique, livre son premier texte de philosophie des sciences. Il y défend une position instrumentaliste, c’est-à-dire qu’il dénie toute portée objective aux théories physiques en leur attribuant seulement la fonction de coordination des lois expérimentales. En ce sens, il s’oppose au réalisme qui leur attribue une portée ontologique. À l’époque, contrairement à ce qu’il fera dans La théorie physique, Duhem accepte l’inductivisme, c’est-à-dire l’idée que les lois expérimentales sont induites à partir des données empiriques. De même, il ne perçoit pas encore ce qu’il y a de problématique dans le contrôle expérimental. Dans cet article, il s’attache surtout à montrer qu’une théorie physique consiste à soulager la mémoire du physicien en l’aidant à retenir plus aisément la multitude des lois expérimentales. Par conséquent, une théorie ne saurait être qualifiée de vraie ou de fausse en fonction de son degré d’adéquation aux données expérimentales. Quant aux hypothèses que doit émettre le physicien, elles ne doivent être vues, selon Duhem, que comme de simples traductions symboliques des lois expérimentales.
Fort de cette conception, Duhem critique les théories mécaniques, c’est-à-dire les théories fondées sur des modèles concrets et non construites comme des représentations symboliques. Il reconnaît qu’elles peuvent être séduisantes, car elles répondent au désir de trouver des explications aux lois expérimentales et donnent ainsi l’impression de saisir la nature des choses. Mais, pour Duhem, il faut résister à cette tentation, en se contentant d’un travail de coordination des lois. Autrement dit, pour Duhem, selon les mots de Stoffel, il faut préférer le physicien prudent au métaphysicien vigoureux. D’ailleurs, Duhem note que si les théories mécaniques ont pu être fécondes à leurs débuts, elles sont abandonnées à mesure que la physique théorique progresse. Elles ne feraient donc preuve que d’une fécondité illusoire.
Ce phénoménalisme de Duhem peut bien sûr faire penser au conventionnalisme d’Henri Poincaré (1854-1912). Duhem le reconnaît, mais il souligne aussitôt qu’il ne faut pas considérer comme équivalentes toutes les théories qui rendent compte d’un même ensemble de lois – ce que Stoffel appelle l’éclectisme. Le physicien mécaniste ne court pas ce risque dans la mesure où il a tendance à considérer qu’une théorie se doit de refléter l’ordre des choses. En revanche, un phénoménaliste, en raison de son refus d’attribuer une portée ontologique aux théories, pourrait regarder de manière équivalente les théories qui fonctionnent. Pour autant, Duhem souligne qu’un phénoménaliste peut privilégier, parmi les théories acceptables d’un point de vue logique, celle qui est la plus englobante et la plus simple. Le phénoménalisme ne conduit donc pas nécessairement à l’éclectisme, voire au scepticisme.
Sur sa lancée, toujours en 1892, Duhem publie « Notation atomique et hypothèses atomistiques » pour montrer la façon dont sa conception des théories physiques s’applique à l’atomisme, qui est un grand sujet de controverse au XIXe siècle. Il y montre donc que l’on peut utiliser la notation atomique sans se rallier aux hypothèses atomistiques. Cette explication lui permet de souligner que l’efficacité d’une théorie ne signifie pas qu’elle reflète la nature des choses.
Ces deux articles, en particulier le premier, ne laissent pas indifférents. Une partie du monde catholique, auquel appartient Duhem, réagit négativement. Duhem avait défendu l’indépendance des théories physiques par rapport aux doctrines métaphysiques, puis avait rompu le lien entre la notation atomique et les hypothèses atomistiques. La théorie chimique pouvait donc être indépendante des considérations des écoles philosophiques sur la nature des corps. Or cette mise à l’écart de la métaphysique n’est guère appréciée des métaphysiciens. Comme l’explique en détail Stoffel, d’aucuns l’accusent de récuser « la vraie physique » en ne cherchant pas à étudier les causes dans leurs effets. Ses idées sont également accusées de conduire au positivisme, au kantisme ou encore au scepticisme, ce qui n’est pas apprécié dans le monde catholique de l’époque. De façon moins virulente, on lui rétorque aussi que les savants n’auraient jamais développé la science s’ils n’avaient pas été animés par le désir de découvrir la réalité.
En 1893, en traitant de questions diverses, comme celle de l’action à distance, Duhem répond implicitement à ses accusations dans « Une nouvelle théorie du monde inorganique ». Il rappelle d’abord que ses idées sont déjà présentes chez de grands savants. Puis, il souligne qu’il ne dédaigne pas la métaphysique. Il défend même l’idée qu’en détachant la métaphysique de la science, il protège la première. Cette mise au point, souligne Stoffel, est bien reçue par certains de ceux qui l’accusaient de mépriser la métaphysique. Mais Duhem est toujours soupçonné de favoriser la pénétration du scepticisme dans la sphère religieuse en l’ayant introduit en science. Puis, pour avoir déclaré la métaphysique indépendante de la physique, il est accusé d’empêcher de remonter de la seconde à la première. Enfin, sur un plan plus technique, Duhem se voit reprocher d’être incohérent dans la mesure où, malgré la distance qu’il a prise avec Poincaré, son phénoménalisme n’apparaît pas compatible avec l’idée qu’il faille opérer un choix entre théories logiquement équivalentes.
Avec la publication de « Physique et métaphysique » en 1893, Duhem précise donc sa pensée. Il commence par rappeler que nous sommes contraints d’acquérir la connaissance des phénomènes (la physique) avant celle de leurs causes (la métaphysique). Mais, comme l’avait avancé un de ses critiques, une fois certaines connaissances métaphysiques acquises de cette manière, celles-ci ne pourraient-elles pas, en retour, être la source de nouvelles connaissances des phénomènes ? En particulier, la métaphysique ne pourrait-elle pas être un guide dans le choix des hypothèses ? Ce n’est pas l’avis de Duhem, qui souligne que cette approche reviendrait à maintenir la science sous la tutelle de la métaphysique. Démarche d’autant plus regrettable que la seconde est trop incertaine pour permettre la découverte de nouvelles lois physiques. Duhem réitère donc sa position que l’intérêt d’une théorie physique est de classer les lois physiques et que le classement qui est ainsi opéré n’a aucune portée métaphysique. Bien que l’idée ne soit formulée explicitement que dans « Physique de croyant » (1905), Duhem laisse ainsi déjà entendre qu’il est absurde de chercher, parmi les théories scientifiques, soit la confirmation, soit la condamnation d’une théorie métaphysique. Mise au point qui lui permet de retourner contre ses critiques les accusations de positivisme ou de scepticisme : c’est en voulant fonder la métaphysique sur la science que l’on entretient l’idée qu’il n’y a pas d’autre méthode que celle de la science et que l’on fait entrer l’incertitude en métaphysique. Le plus novateur dans cet article est toutefois la référence que Duhem fait à l’existence d’une tradition phénoménaliste à côté de la tradition mécaniste, plus connue. Cette découverte, qui sera exploitée dans ses futures recherches historiques, lui permet de répondre à l’objection que la recherche de l’explication métaphysique des choses est le moteur de la science. Maintenant, il peut opposer à cette thèse la fécondité des savants qui n’ont fait que chercher à sauver les phénomènes.
Après avoir essuyé de nouvelles critiques, Duhem publie « L’École anglaise et les théories physiques », toujours en 1893. L’article lui permet de compléter ses réponses à trois objections qui lui ont été adressées, à savoir de ne fournir aucune indication dans le choix des hypothèses, de ne pas bien rendre compte de la motivation des physiciens s’ils ne sont plus animés par l’objectif de dévoiler la réalité et d’être maladroit en défendant des théories à la fois phénoménalistes et cohérentes. Duhem présente alors, pour la première fois, sa doctrine de la classification naturelle. Assouplissant sa distinction entre physique et métaphysique, il soutient que, par sa cohérence, une théorie s’approche d’une classification naturelle des lois physiques, c’est-à-dire qu’elle exprime « des rapports métaphysiques qu’ont entre elles les essences dont émanent ces lois ». L’objectif d’une théorie physique n’est donc plus uniquement mnémotechnique. Son but répond aussi à une recherche de cohérence reflétant un ordre naturel. Cette inflexion de Duhem lui permet de moins se défier de la tendance réaliste des physiciens. Il reconnaît maintenant que celle-ci peut être satisfaite indirectement. Il précise simplement que ce n’est pas en adoptant une posture réaliste que le physicien se rapproche de la nature des choses, mais en recherchant la cohérence à travers une posture phénoménaliste.
En 1894, avec « Quelques réflexions au sujet de la physique expérimentale », Duhem marque une nouvelle rupture, cette fois-ci avec l’inductivisme de ses premiers écrits. Il souligne aussi l’impossibilité de toute réfutation d’une hypothèse isolée et opère sa critique de l’expérience cruciale. Cette critique implique que la portée d’une contradiction entre une théorie et les observations n’a pas la portée de la réduction à l’absurde des mathématiciens. Certes, ce conflit signale l’existence d’une erreur dans la théorie, mais celle-ci ne concerne pas nécessairement l’hypothèse testée. En soi, cette critique est déjà un élément fondamental de l’analyse de Duhem. Mais elle permet aussi de répondre une nouvelle fois au reproche concernant le choix des hypothèses, et a fortiori de la méthode inductive. Si Duhem n’offre pas de consignes claires concernant ce choix, c’est parce qu’il n’y a pas d’hypothèses indépendantes d’une théorie et parce que le contrôle expérimental, jamais définitif, n’intervient pas avant la fin de la constitution de la théorie.
En 1896, Duhem conclut cette série d’articles avec « L’évolution des théories physiques du XVIIe siècle jusqu’à nos jours ». Il y réhabilite les qualités dans les sciences et retrace le remplacement de la mécanique par la thermodynamique. Puis, à la toute fin, il évoque très rapidement l’action d’une Providence qui dirige l’histoire des théories physiques. Les trois points sont liés puisqu’en reconnaissant le caractère irréductible des qualités à des quantités, Duhem souligne les limites de la mécanique qui repose sur les seules notions de matière, de mouvement et de force. La thermodynamique se présente alors comme la nouvelle « science reine ». Quant à cette dynamique de l’histoire des sciences, elle inspire à Duhem l’image d’un accomplissement qui ne peut être que guidé par « Celui qui mène toute cette agitation ». Après avoir rejeté toute prétention à chercher un enseignement métaphysique dans les théories physiques, Duhem en trouve donc un dans leur histoire.
Stoffel y décèle une certaine naïveté. Duhem se serait laissé emporter dans cette vision optimiste et providentielle de l’histoire des sciences. Lui qui avait souvent rappelé qu’il ne faut pas prendre comme une destination finale ce qui n’est qu’une étape provisoire, il se serait finalement laissé aller à adopter l’attitude dogmatique qu’il a si souvent critiquée chez les autres. En tout cas, ces articles illustrent bien la sophistication de la pensée de Duhem et permettent de mieux comprendre comment celle-ci s’est élaborée. Leur publication en un ouvrage et l’introduction qu’en fait Stoffel s’avèrent donc très utiles.
Thomas Lepeltier,
Revue philosophique de Louvain,
2024.
Pour acheter Realtà e rappresentazione : Amazon.fr.
Pour acheter Introduction à la lecture des célèbres articles duhémiens : Amazon.fr.