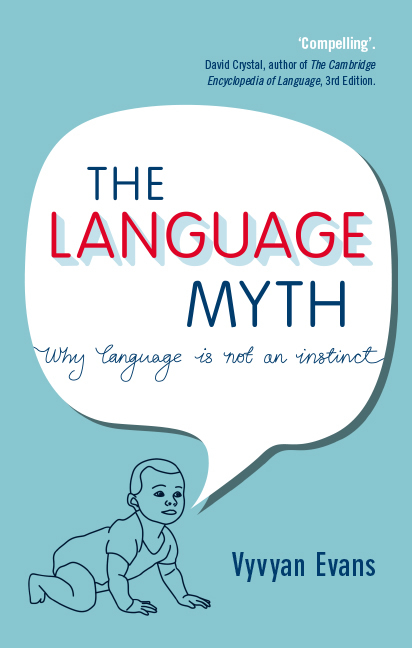The Language Myth.
Why Language Is Not an Instinct,
de Vyvyan Evans,
Cambridge University Press, 2014.
Comment les enfants apprennent-ils à parler ? C’est-à-dire comment arrivent-ils à maîtriser une langue, ayant bien souvent une grammaire complexe, en un laps de temps relativement court ? Face à cette prouesse, des linguistes, dont le célèbre Noam Chomsky, ont imaginé dans les années 1950 que notre capacité linguistique serait innée. Outre une anatomie qui se prête à la vocalisation, nous naîtrions avec des règles grammaticales de base encodées dans notre structure neuronale. Ce qui implique que toutes les langues ayant été parlées par l’humanité, quelle que soit leur diversité, auraient en commun une « grammaire universelle ». Qui plus est, cet « instinct du langage », fruit de l’évolution, serait propre à l’espèce humaine. Les animaux non humains ne disposeraient que de méthodes de communication rudimentaires qui ne pourraient pas être considérées comme des langues à proprement parler.
C’est contre cette conception, admise par nombre de spécialistes et popularisée par le best-seller de Steven Pinker, L’instinct du langage (1994), que s’érige ici Vyvyan Evans. Ce linguiste veut bien reconnaître que, il y a soixante ans, cette idée pouvait être considérée comme une intéressante hypothèse de travail. Mais, au vu des recherches actuelles, il estime qu’elle n’est plus tenable. Elle ne reposerait sur aucune donnée empirique et serait même largement contredite, comme il tente de le démontrer dans ce livre.
D’abord, Evans montre que le langage humain n’est pas fondamentalement différent des formes de communication des autres animaux. Plus on étudie leurs façons de communiquer, plus on constate en effet que toutes les caractéristiques du langage humain s’y retrouvent, à des degrés divers en fonction de l’espèce. Ensuite, à coup de contre-exemples, Evans montre que la thèse d’une « grammaire universelle » est contredite par la grande diversité des structures syntaxiques des langues humaines. Comment les enfants apprennent-ils donc leur langue maternelle ? En s’appuyant sur de nombreuses études, Evans soutient que cette faculté peut se développer à partir de facultés intellectuelles diverses, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un innéisme des règles de grammaire. L’apprentissage de la langue maternelle se ferait naturellement à coup d’essais et d’erreurs. Evans peut alors réfuter l’idée qu’il y aurait un module particulier du cerveau humain qui serait spécialisé dans le langage. Pour cela, il lui suffit de rappeler que les tentatives récentes pour l’identifier ont plutôt mis en avant la grande plasticité du cerveau. Enfin, Evans déconstruit deux thèses associées à ce « mythe » de l’instinct du langage. D’abord, il démonte celle qui postule l’existence d’un « langage de la pensée », qui serait une sorte de langage interne au cerveau d’où dériverait toute pensée avant que celle-ci soit exprimée dans une langue particulière ; puis Evans s’en prend à la thèse selon laquelle il y aurait une pensée indépendante du langage.
Disons-le tout net : ce démontage en règle de la thèse de l’instinct du langage est convaincant. Bien sûr, il faut toujours attendre de voir comment ses partisans vont répondre à ces critiques. Mais on peut déjà percevoir que l’enjeu de ces débats est loin d’être uniquement théorique. La réfutation de cette thèse, si elle se confirmait, devrait en effet nous inciter, entre autres, à regarder différemment les animaux non humains. Finalement, à des degrés divers, ils parleraient un peu comme nous…
Thomas Lepeltier, Sciences Humaines, 268, mars 2015.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
Autres livres à signaler :
— David McNeill, How
Language Began. Gesture and Speech in Human Evolution,
Cambridge University Press, 2012.
— Michael A. Arbib, How
the Brain Got Language. The Mirror System Hypothesis,
Oxford University Press, 2012.