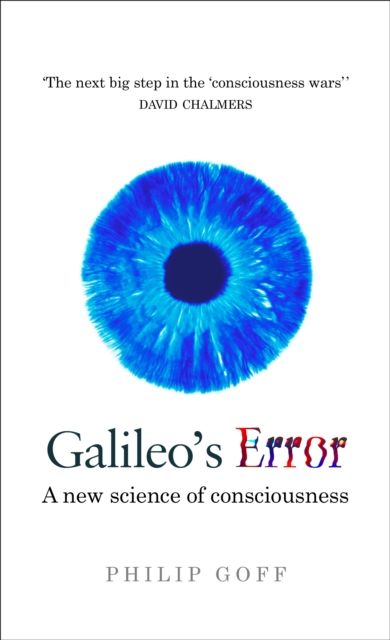Galileo’s Error.
Foundations for a New Science of Consciousness,
de Philip Goff,
Rider, 2019.
Si tout n’est que matière, qu’est-ce que la conscience ? Elle relève manifestement d’une expérience subjective qui peut difficilement être décrite de manière quantitative : elle ne se mesure pas, ne se pèse pas, ne s’observe pas. Mais si elle est distincte de la matière, comment interagit-elle avec cette dernière ? Telles sont les questions qui surgissent dès que l’on essaye de réfléchir à la nature de la conscience. Traditionnellement, les deux grandes façons de l’appréhender sont le dualisme et le matérialisme. La première distingue deux catégories d’entités : les entités matérielles, qui l’on peut étudier à travers la physique, la chimie ou la biologie, et les entités incorporelles comme les consciences, qui échappent à l’investigation scientifique. La seconde approche postule qu’il n’y a rien d’autre que la matière, c’est-à-dire que la conscience est soit un phénomène émergent de l’activité cérébrale, soit un processus qui s’identifie à cette activité. Mais, pour Philip Goff, ces deux approches sont des impasses. Comme ce philosophe tente de le montrer dans ce livre, il est plus cohérent de considérer que la conscience est une caractéristique inhérente à la matière. C’est ce que l’on appelle le panpsychisme.
Une des grandes difficultés du dualisme est de rendre compte de la façon dont un esprit immatériel pourrait être cause d’une action physique sans apparaître comme une sorte de miracle qui viendrait faire irruption dans une chaîne causale de processus cérébraux. Du côté de l’approche matérialiste, la grande difficulté est d’expliquer comment une conscience subjective peut être identique à une activité neuronale. On peut certes dire que la conscience émerge du fonctionnement du cerveau mais, si cette émergence n’est pas elle aussi d’ordre matériel, c’est donc qu’il existe une entité autre que la matière et l’on sort alors du matérialisme ; si l’émergence est matérielle, on en revient au problème de l’identité entre qualités subjectives et propriétés objectives. Pour Goff, ces difficultés viennent du fait que, dans l’approche scientifique standard, qu’il fait remonter à Galilée – d’où le titre de l’ouvrage –, le monde doit uniquement être appréhendé en termes quantitatifs.
Pour sortir de ces impasses, il défend donc la thèse du panpsychisme. L’avantage est que cette dernière n’est pas confrontée à la mystérieuse interaction de l’esprit avec une matière cérébrale de nature différente (cas du dualisme) ni avec l’inexplicable apparition d’une subjectivité à partir de processus neurologiques (cas du matérialisme). Cette théorie ne signifie pas que tout est conscient – par exemple, il y a peu de chance qu’une chaussette soit consciente en tant que telle –, mais que les constituants élémentaires de la matière le sont, ainsi que certaines de leurs combinaisons. Elle n’implique pas non plus qu’une conscience comme la nôtre se retrouve partout : la conscience d’une particule élémentaire n’a pas le niveau de complexité de celle qui émane d’un cerveau humain. Ainsi posée, l’objectif du panpsychisme est d’expliquer comment une conscience complexe, comme celle des humains, procède de la combinaison de consciences élémentaires présentes dans la matière cérébrale. La tâche n’est pas aisée et Goff, qui le reconnaît, se contente de suggérer des pistes de recherche. Mais il fait bien remarquer que cette perspective s’avère plus prometteuse que les approches dualistes et matérialistes. En tout cas, il est certain que son livre expose très bien les termes de ce débat fondamental.
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
340, octobre 2021.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
ou Place
des libraires.