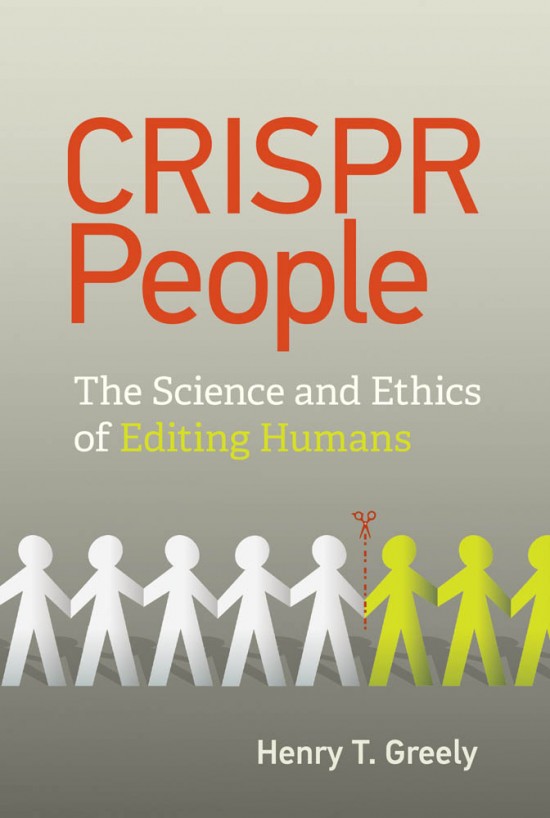CRISPR People.
The Science and Ethics of Editing Humans,
de Henry T. Greely,
The MIT Press, 2021.
En novembre 2018, le biophysicien chinois He Jiankui révéla qu’il avait implanté, dans l’utérus de leur mère, deux embryons humains génétiquement modifiés à l’aide de la technique d’édition de l’ADN connue sous le nom de CRISPR. L’objectif officiel de l’expérience était de produire des bébés immunisés contre l’infection par le VIH en modifiant un récepteur clé du virus. Deux jumelles avec cette caractéristique étaient ainsi nées en Chine juste un mois avant cette révélation. La nouvelle suscita un tollé, autant dans l’opinion publique que dans la communauté scientifique. He Jiankui fut même condamné à trois ans de prison par la justice chinoise. Mais, au-delà de sa dimension rocambolesque, cette histoire soulève une question fondamentale : est-il moralement légitime ou non d’opérer chez des humains des modifications génétiques qui seront héritées par leur progéniture ? Après avoir analysé en détail ce que l’on sait de l’expérience de He Jiankui et les différentes réactions qu’elle a suscitées, c’est la question que pose dans ce livre Henry Greely, professeur de droit spécialisé en bioéthique.
Pour Greely, la modification héréditaire du génome opérée par He Jiankui était imprudente et immorale. Déjà, elle était prématurée du point de vue des connaissances nécessaires pour la rendre aussi sûre qu’un traitement expérimental peut l’être. Ensuite, le chercheur chinois ne semble pas avoir obtenu le consentement éclairé des parents des jumelles dans la mesure où la procédure ne leur a pas été bien expliquée. Enfin, l’expérience a ignoré l’actuel consensus scientifique selon lequel l’édition du génome humain ne devrait être utilisée que pour traiter des affections graves pour lesquelles il n’y a pas d’autre option. Or, selon Greely, l’objectif d’opérer une manipulation génétique pour conférer une protection contre le VIH ne s’imposait pas car il existe des moyens fiables de prévenir cette infection et de réduire la charge virale.
Pour autant, Greely soutient que l’édition du génome humain n’est pas intrinsèquement mauvaise sur le plan moral. Il souligne en effet qu’il n’y a pas vraiment de « génome humain », mais autant de génomes qu’il y a de personnes sur la planète et que ces génomes évoluent constamment. Les modifications en laboratoire ne peuvent donc pas vraiment être considérées comme problématiques sur le plan éthique. Greely estime toutefois que, pour être légitimes, elles doivent répondre à au moins quatre critères : elles doivent être suffisamment sûres, elles ne doivent pas réduire la diversité génétique de la population (en diminuant, par exemple, le nombre de personnes ayant certaines caractéristiques qui, en soi, ne posent pas de problème), ni acroître les inégalités sociales et elle ne doivent pas chercher à régler des problèmes pouvant être traités par d’autres méthodes (notamment par des diagnostiques préimplantatoires).
D’aucuns pourraient bien sûr toujours s’inquiéter de manipulations dignes de la science-fiction. Mais Greely estime que nous n’en savons pas assez sur le fonctionnement du génome pour opérer ces transformations que beaucoup craignent (par exemple, on ne sait pas vraiment augmenter l’intelligence, qui est multifactorielle). Tout en soulignant la nécessité de bien contrôler les techniques d’édition du génome, il se veut donc quand même rassurant. Reste que les limites d’aujourd’hui seront peut-être largement dépassées demain. Les questions éthiques concernant la transformation du génome humain n’ont donc pas fini de se poser…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
341, novembre 2021.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr.