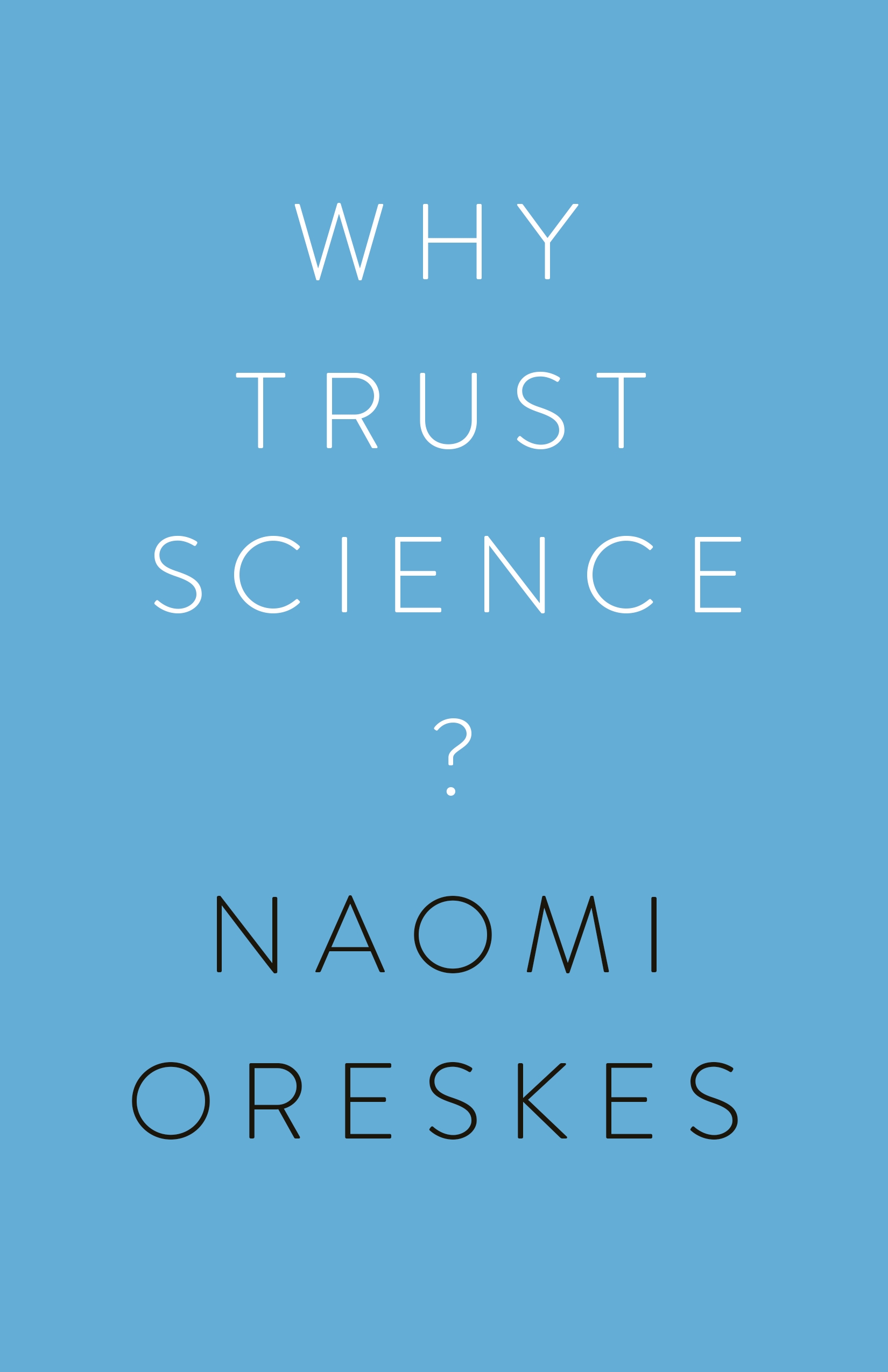Why Trust Science ?,
de Naomi Oreskes,
Princeton University Press, 2020.
La théorie darwinienne de l’évolution, l’utilité des vaccins et la responsabilité anthropique du réchauffement climatique sont des exemples classiques de discours scientifiques contestés par certaines parties de la population. Cette attitude de rejet peut étonner tant ces théories semblent bien établies. En même temps, le scepticisme n’est-il pas inhérent à la démarche scientifique ? Puis, sachant qu’il arrive à des théories scientifiques bien établies d’être réfutées, n’est-il pas sensé de prendre du recul même avec celles qui ont, de nos jours, la faveur de la communauté scientifique ?
Pour Naomi Oreskes, cette défiance repose toutefois sur une mauvaise conception de l’activité scientifique. Cette historienne des sciences ne prétend pas qu’il existe une méthode scientifique garantissant de façon indubitable la validité des théories scientifiques. Mais elle estime qu’il faut faire confiance à celles qui font consensus parce qu’elles sont le fruit d’un processus rigoureux de vérification, de contrôle et d’évaluation. Qui plus est, à la différence des discours contestataires, elles procèdent d’un haut niveau d’expertise. Certes, il peut être de bon ton de décrier le rôle des experts. Pourtant, nous comptons chaque jour sur des spécialistes : les dentistes pour soigner nos dents, les plombiers pour réparer nos tuyauteries, etc. Pourquoi les experts en matière scientifique seraient-ils moins dignes de confiance ?
Bien sûr, les scientifiques peuvent collectivement se tromper. Les climatosceptiques, par exemple, aiment ainsi rappeler que, au début du xxe siècle, les géologues ont eu tort de rejeter la théorie de la dérive des continents. Ils en concluent que les climatologues actuels, en dépit de leur confiance dans leur théorie, pourraient aussi se tromper sur le changement climatique. Mais Oreskes montre que ce parallèle ne tient pas car, historiquement, ce rejet de la théorie de la dérive des continents, même s’il fut important, n’a jamais fait consensus. Ce qui n’est pas le cas de la théorie de l’origine anthropique du réchauffement climatique. Les plus sceptiques pourraient rétorquer qu’un consensus peut cacher des biais cognitifs liés au statut des chercheurs (position sociale, sexe, origine géographique, etc.). C’est vrai, reconnaît Oreskes. Elles donnent d’ailleurs des exemples d’une médecine dominée par des hommes ayant conduit à des conceptions biaisées de la santé des femmes. Mais ce risque ne doit pas entraîner un rejet du discours scientifique, estime-t-elle. Il doit simplement inciter à diversifier l’origine et le profil des chercheurs. Cela dit, même dans le meilleur des cas, rien ne garantit absolument la validité d’une théorie. Là encore, ce n’est pas une raison suffisante, avance Oreskes, pour douter des théories bénéficiant des meilleures garanties. En référence au pari pascalien, elle montre en effet que l’on a plus à perdre en ne faisant pas confiance à ces théories qu’en y adhérant.
Cette mise au point historique et méthodologique peut-elle suffire à ramener les sceptiques vers les théories scientifiques faisant consensus ? Oreskes en doute car, comme elle le montre, c’est bien souvent pour les valeurs qu’elles semblent véhiculer, et non en raison d’objections techniques, que certaines théories sont rejetées. Le climatoscepticisme se nourrit ainsi de la peur de l’interventionnisme d’État. Mais Oreskes pense que les scientifiques pourraient quand même atténuer l’opposition à leur théorie de prédilection en montrant aussi que ce conflit des valeurs n’a pas lieu d’être. Reste à savoir si elle ne pèche pas par optimisme…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
323, mars 2020.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr.