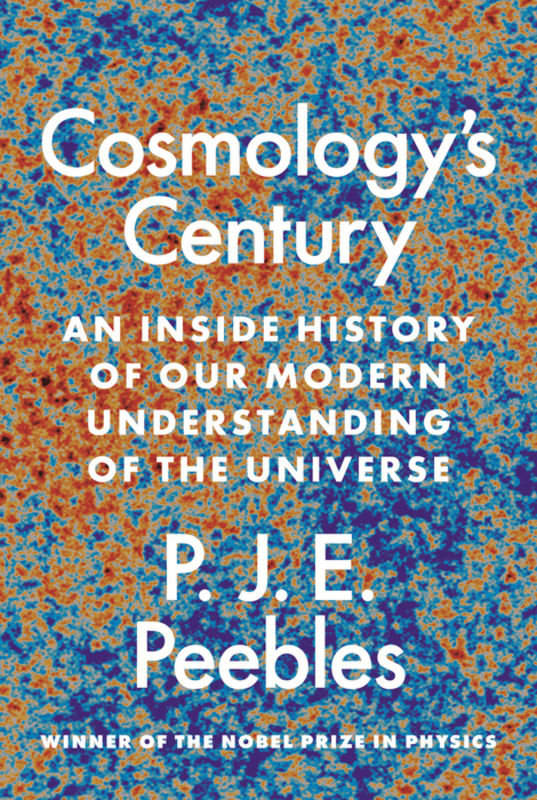Cosmology’s Century.
An Inside History of Our Modern
Understanding of the Universe,
de James Peebles,
Princeton University Press, 2020.
James Peebles, né en 1935, a obtenu le prix Nobel de physique en 2019. D’après la déclaration de l’Académie royale des sciences de Suède, il a été récompensé pour des « découvertes théoriques [ayant] contribué à notre compréhension de l’évolution de l’univers après le big bang ». En particulier, ses travaux ont aidé à révéler « un univers dont on ne connaît que cinq pour cent du contenu, la matière qui constitue les étoiles, les planètes, les arbres – et nous. Le reste, soit quatre-vingt-quinze pour cent, est de la matière noire et de l’énergie noire inconnues. C’est un mystère et un défi pour la physique moderne ». Dès 1964, Peebles a en effet prédit certaines des propriétés du rayonnement cosmologique, dont la découverte en 1965 joua un rôle important dans l’acceptation du modèle du big bang par la communauté scientifique. Parmi une multitude d’autres travaux, il a également contribué à expliquer la structure et l’évolution des galaxies, puis a été l’un des premiers promoteurs dans les années 1990 de la version désormais standard du modèle du big bang, à savoir la version ΛCDM (pour « Lambda-Cold Dark Matter »). James Peebles n’est donc pas l’homme d’une découverte, mais un des acteurs clefs du développement de la cosmologie moderne et, en tant que tel, un chercheur éminemment respecté.
Dans ce livre qui s’adresse à des lecteurs avertis, Peebles retrace l’évolution de la cosmologie, du premier modèle d’univers d’Albert Einstein jusqu’aux travaux les plus contemporains. Comme le sous-titre du livre l’indique, c’est le regard d’un observateur impliqué dans son objet d’étude qui nous offre, de l’intérieur, ses réflexions sur les multiples travaux ayant participé au développement de cette discipline. Dans un récit qui fourmille donc d’analyses autant d’observations que de travaux théoriques, son objectif principal est de montrer que différents axes de recherche indépendants au cours du XXe siècle ont convergé entre les années 1998 et 2003 pour assoir le modèle ΛCDM sur de solides bases. Pour caractériser cette convergence, Peebles parle à plusieurs reprises de « révolution ». Le mot peut surprendre puisque la consolidation de ce modèle n’entraîne pas de renversement de perspective dans la vision du cosmos. Par ajouts successifs d’ingrédients ou d’hypothèses (processus inflationnaire, matière noire et énergie noire représentée par la constante cosmologique Λ), le modèle ΛCDM s’est construit en effet petit à petit à partir des années 1970 pour expliquer un nombre croissant d’observations et supprimer des anomalies. En outre, le concept de convergence traduit l’idée de résultats qui tendent à s’unir, à s’harmoniser ou à s’accorder et non d’un changement radical. Mais, pour Peebles, la « réduction de la confusion [dans la cosmologie] au cours des années 1998-2003 fut suffisamment importante pour qu’elle puisse être appelée une révolution » (p. 11). Peebles appelle donc « révolution » la stabilisation d’un programme de recherche autour d’un modèle précis. Il se montre d’ailleurs très confiant à propos de la validité de ce modèle. Évoquant la possibilité que de nouvelles observations obligent les cosmologistes à opérer des changements théoriques, il écrit ainsi que la nouvelle « théorie prédira un univers très similaire au modèle ΛCDM, parce que ce qui est observé semble tellement correspondre au modèle ΛCDM » (p. 340). Puis, quelques lignes plus loin, il ajoute : « je ne m’attends pas à ce que le modèle ΛCDM soit supplanté, en dehors de quelques modestes ajustements » (p. 340).
Il est délicat de contredire un chercheur ayant le niveau d’expertise de Peebles. Pourtant, on ne peut qu’être frappé par la confiance que ce chercheur peut avoir dans la validité du modèle ΛCDM au regard de l’actuelle situation de la cosmologie où, comme cela fut rappelé lors de l’attribution de son prix Nobel, les cosmologistes ne connaissent que cinq pour cent du contenu énergétique de l’univers observable ; le reste étant de nature inconnue. Peebles reconnait lui-même que la détection d’une matière non baryonique, depuis des décennies que l’on cherche en vain à l’observer, relève d’un « rêve […] insatisfait » (p. 299). Mais cela ne lui semble pas suffisant « pour argumenter contre le postulat » (p. 299) de son existence. À ce stade de la recherche, il est impossible de dire si la confiance de Peebles est fondée ou non. Seul l’avenir pourra le dire. En tout cas, comme ce livre en témoigne, force est de reconnaître que Peebles ne manque pas d’arguments pour justifier sa position, même si la conception de l’univers à laquelle il adhère reste « un mystère et un défi pour la physique moderne ».
Thomas Lepeltier,
Revue des
questions scientifiques, 192 (1-2), 2021.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr.