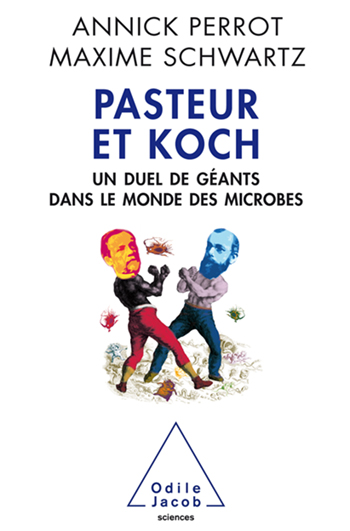Pasteur et Koch.
Un duel de géants dans le monde des microbes,
de Annick Perrot et Maxime Schwartz,
Odile Jacob, 2014.
Louis Pasteur et Robert Koch sont les deux grands fondateurs de la bactériologie. Le premier est français ; le second allemand. Ils ont tous deux réussi à montrer que certaines maladies sont causées par des micro-organismes. Mais, entre eux, le courant ne passe pas. À cause de maladresses, d’une mauvaise circulation de l’information scientifique, de malentendus d’origine linguistique, de problèmes d’égo et de sentiments nationalistes exacerbés par la Guerre franco-allemande de 1870, les deux savants entretiennent une relation exécrable. Cela dit, pour les deux auteurs de ce livre, cette inimitié n’a pas toujours été stérile. En conduisant les deux savants à se surpasser, pour mieux triompher de l’autre, elle aurait joué un rôle positif dans leurs découvertes.
Quand Koch fait irruption dans le monde de la recherche, Pasteur, de vingt ans son aîné, est déjà un savant reconnu. La première « fâcherie » a lieu en 1876 à propos de la maladie du charbon qui décime le bétail. Koch vient de montrer qu’elle est causée par une bactérie mais, en rendant compte de ses résultats, il omet de citer la découverte préalable de Pasteur des spores bactériennes. Quant à ce dernier, il présente ensuite la découverte de l’étiologie de cette maladie en mettant en avant le rôle de savants français, sans reconnaître celui, prépondérant, de Koch. Ces maladresses, voire mesquineries, annoncent d’autres tensions. Mais les deux savants s’opposent aussi pour des raisons plus profondes. Notamment, Koch reste sceptique vis-à-vis de l’idée que l’on puisse atténuer la virulence des microbes, alors que Pasteur, adoptant une conception moins fixiste du vivant, s’efforce de montrer que c’est possible. L’opposition de son confrère allemand redouble d’ailleurs son ardeur à montrer que les espèces bactériennes se transforment. L’histoire lui donnera raison et cette caractéristique jouera un rôle clef dans le développement de la vaccination.
La rivalité a donc été une fructueuse source d’émulation. En même temps, on ne peut s’empêcher de se demander si, à certains moments, une franche collaboration entre les deux savants n’aurait pas été préférable. Quoi qu’il en soit, en racontant l’histoire des débuts de la bactériologie à travers la rivalité de ses deux fondateurs, cet ouvrage nous offre un récit vivant, didactique, très agréable à lire et qui a le mérite de rappeler la dimension humaine de l’activité scientifique. En ce sens, c’est un ouvrage parfaitement réussi…
Thomas Lepeltier, Pour la science, 451, mai 2015.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr