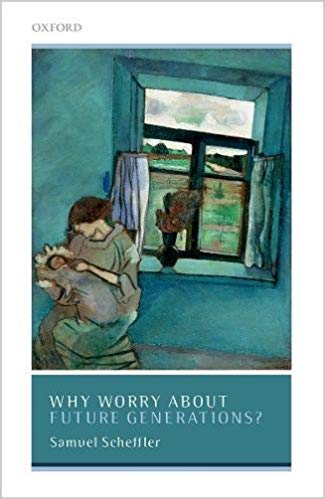Why Worry About Future Generations ?,
de Samuel Scheffler,
Oxford University Press, 2018.
Pourquoi faudrait-il se soucier des générations futures ? S’il paraît normal de se préoccuper de l’avenir de ses enfants, petits-enfants et de leurs proches, pourquoi s’en faire pour ces inconnus qui peupleront la planète dans 200, 300 ou 500 ans ? A priori, rien ne nous oblige à nous soucier de personnes qui n’existent pas encore et avec qui nous n’aurons aucune relation. Qui plus est, comment savoir ce que les générations futures souhaiteront ? Préféreront-elles vivre à la campagne ou dans des villes, avoir des hivers rigoureux ou tempérés, manger des produits de synthèse ou naturels, et ainsi de suite ? Comme nous n’en savons rien, pas la peine de se compliquer la vie. Enfin, comment des personnes appartenant à des générations futures pourraient-elles nous reprocher de ne pas avoir fait des efforts pour protéger notre environnement puisque, si nous avions changé notre façon de vivre, ces personnes ne seraient pas nées (d’autres auraient vu le jour, mais pas les mêmes) ? Autant dire que nous ne devons rien aux générations futures !
L’idée est tentante, mais ces arguments sont discutables, comme le souligne le philosophe Samuel Scheffler dans ce livre. L’absence de lien affectif, l’ignorance des conditions futures de bien-être et l’impossibilité à désigner des bénéficiaires précis de nos efforts impliquent-elles vraiment une absence d’obligation envers les générations futures ? C’est peu probable. À cette position, la plupart des spécialistes de philosophie éthique opposent en effet le principe d’indistinction : de la même façon que l’on ne doit pas faire de mal à autrui, qu’il soit né à côté de chez nous ou à l’autre bout de la planète, on ne devrait pas nuire à une personne, qu’elle naisse à notre époque ou dans le futur. Certes, on ne peut être certain de ce que « bien vivre » signifiera dans quelques siècles, mais il ne fait guère de doute qu’un environnement, par exemple, fortement contaminé par des déchets radioactifs ne sera pas un facteur de bien-être. À nous donc de veiller à ne pas laisser une Terre trop saccagée. Le problème est qu’il est difficile d’être plus précis. Par exemple, faut-il œuvrer pour que la taille de la population humaine diminue, se stabilise ou augmente ? En outre, ce principe d’indistinction n’apparaît pas très mobilisateur.
Pour Samuel Scheffler, se soucier des générations futures est pourtant crucial pour le temps présent. Ce philosophe soutient en effet que la pérennité de l’état du monde est ce qui donne du sens à nos actions ici et maintenant. Imaginez que, dans un siècle, ce à quoi vous tenez aujourd’hui disparaisse et, d’un seul coup, vous aurez moins d’ardeur à vous y investir. Agir dans le présent, c’est donc implicitement œuvrer pour le long terme. Ce souci répond bien sûr à notre intérêt. En même temps, il traduit un réel souci de l’humanité future. Ne serions-nous pas triste en apprenant sa disparition prochaine ? L’auteur avance également que considérer qu’une chose a de la valeur, c’est vouloir qu’elle survive dans le futur. Et, réciproquement, sa survie contribue à lui conférer de la valeur. Voilà de quoi nous motiver à perpétuer notre monde. Cela dit, se soucier ainsi des générations futures ne serait-il pas faire preuve de conservatisme ? L’auteur ne le nie pas. Mais, à ses yeux, ce n’est pas un problème tant que nous restons ouvert à l’évolution du monde. Reste à savoir si, derrière les déclarations en faveur d’une protection de la planète, ce n’est pas le conservatisme qui l’emporte sur le souci des générations futures…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
307, octobre 2018.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
Autre livre à signaler :
— Rahul Kumar (ed), Ethics and Future Generations, Routledge, 2017.