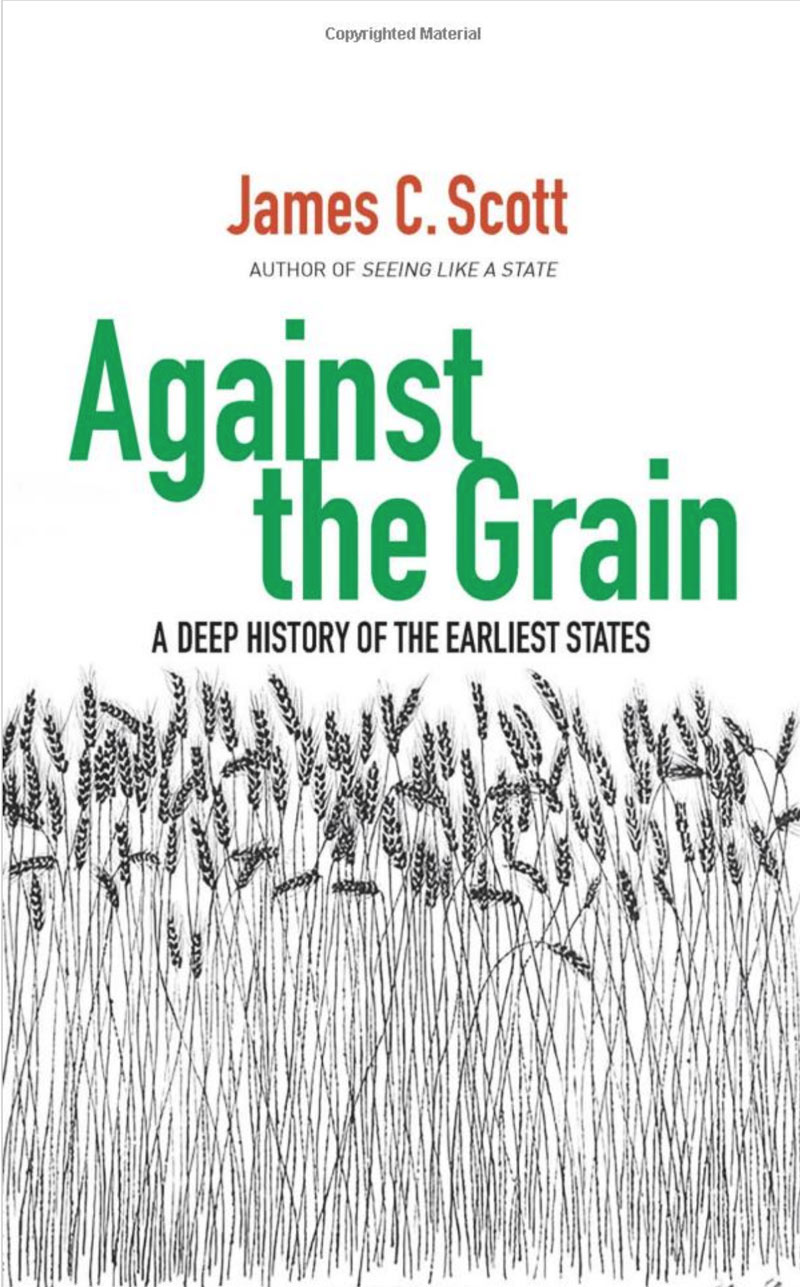Against the Grain.
A Deep History of the Earliest States,
de James C. Scott,
Yale University Press, 2017.
La formation des premiers États apparaît comme une suite logique de la sédentarisation qui accompagna le développement de l’agriculture. En général, les historiens présentent cette évolution sociale de manière assez positive, dans la mesure où elle aurait permis aux chasseurs-cueilleurs de quitter une vie misérable pour des conditions davantage propices au développement culturel. L’architecture, l’écriture, la science seraient ainsi nées des premières structures étatiques. Pourtant, comme James Scott le fait remarquer dans ce livre, ce scénario classique est confronté à des découvertes archéologiques qui révèlent un hiatus : entre environ 8000 et 3500 ans avant l’ère commune, on observe des communautés maitrisant les techniques de l’agriculture et développant un artisanat, mais aucune où l’autorité étatique ne semble présente. Pour ce professeur de science politique, la raison est que les premiers chasseurs-cueilleurs résistèrent au développement de la « civilisation ». D’ailleurs, même après la création des premiers États, la plupart des communautés qui gravitaient autour n’auraient pas cherché à s’y assimiler pendant des millénaires. Pour qu’elles se soumettent à un État, il a fallu qu’elles aient eu faim, peur ou aient été contraintes.
Selon J. Scott, ce phénomène s’explique par les bénéfices que ces communautés indépendantes pouvaient retirer d’une vie mixant chasse, cueillette et agriculture : en exploitant une grande variété de ressources pour s’alimenter, elles avaient les moyens de compenser tout manque temporaire ; en vivant en petites structures, elles étaient plutôt épargnées de la diffusion des maladies ; en étant mobile, leurs membres n’étaient pas contraints à des tâches répétitives et soumis à un pouvoir coercitif ; et ainsi de suite. Or tous ces avantages allaient disparaître une fois sédentarisées. La transition a bien sûr dû être progressive. En se rendant de plus en plus dépendantes des plantes cultivées, les premières communautés perdaient en mobilité. À force de domestiquer des animaux, leurs membres devinrent moins actifs et réduisirent la variété de leur alimentation, au détriment de leur santé. En vivant davantage les uns sur les autres, à proximité du bétail, ils favorisèrent la propagation des maladies. Puis, en se sédentarisant complètement, ils créèrent les conditions d’émergence de pouvoirs centralisés.
Ces premières structures étatiques durent créer des corps d’administrateurs et des forces de maintien de l’ordre. Elles se devaient aussi de construire des cités et d’ériger des murailles pour se protéger. Pour fonctionner, il fallait donc prélever des impôts. Elles orientèrent alors l’agriculture vers les céréales (grain, en anglais) puisque c’est une production très facilement imposable : se récoltant à un moment précis de l’année, il est difficile pour les fermiers d’éviter les inspections (à la différence des tubercules, par exemple, davantage cultivés par les communautés non soumises au joug d’un État). Ces premières structures étatiques avaient également besoin de maintenir, très souvent par la contrainte, leur population sur leur territoire. Enfin, pour disposer d’une main d’œuvre suffisante, elles mettaient allègrement en esclavage les populations environnantes.
Dans ces conditions, on comprend pourquoi les premières communautés humaines résistèrent à l’étatisation plus ou moins inéluctable de leur mode de vie, c’est-à-dire pourquoi elles allèrent against the grain. Pour elles, la naissance des États représentait finalement un destin tragique…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
303, mai 2018.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
Autre livre à signaler :
— James Suzman, Affluence without Abundance. The disappearing world of the Bushmen, Bloomsbury, 2017.