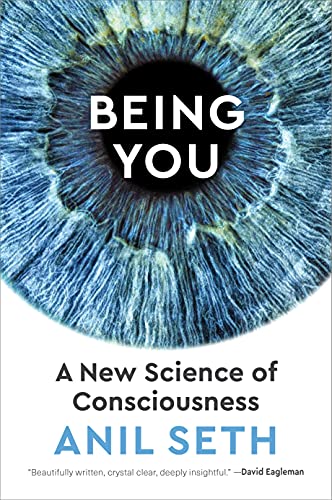Being You.
A New Science of Consciousness,
de Anil Seth,
Faber & Faber, 2021.
Qu’est-ce qu’être conscient ? Que représentent cette subjectivité qui vous définit, cette impression d’être vous, ces sensations que vous éprouvez ? Tel est le problème classique de la conscience sur lequel butent depuis longtemps philosophes et scientifiques. Pour aborder ces questions, il est d’usage de distinguer depuis les années 1990, avec le philosophe David Chalmers, les « problèmes faciles » du « problème difficile » de la conscience. Les premiers concernent la façon dont le cerveau fonctionne. Sur un plan pratique, ce ne sont pas des problèmes faciles, mais ils ne posent pas de difficultés particulières sur un plan conceptuel. Les complications ne sont que d’ordre technique. Le second consiste à expliquer pourquoi et comment certains processus cérébraux s’accompagnent d’une expérience consciente. Autrement dit, pourquoi ne sommes-nous pas juste des automates en chair et en os ? Certains ont pu croire que la résolution des problèmes faciles permettrait de trouver une réponse au problème difficile, mais force est de constater que les progrès en neuroscience de ces dernières décennies n’ont pas fait avancer notre compréhension de la conscience. Pour tenter de sortir de cette impasse, le neuroscientifique Anil Seth propose de se tourner vers ce qu’il appelle le « problème réel » de la conscience : il consiste non à expliquer les processus cérébraux indépendamment de leur dimension subjective (problèmes faciles), ni directement la conscience dans ce qu’elle a justement de subjectif (problème difficile), mais à rendre compte des différentes propriétés de la conscience en termes de processus physiques.
Seth commence ainsi par montrer que les neuroscientifiques ont désormais les moyens, en étudiant la façon dont certaines parties du cerveau interagissent entre elles, d’identifier différents niveaux de conscience. Ces nouvelles techniques permettent notamment de distinguer les états végétatifs de ceux relatifs à une conscience minimale, ce qui peut être crucial dans les cas d’individus atteints du locked-in syndrome. Mais, à côté de cet aspect thérapeutique, ce type d’investigation révèle que, au-delà d’un seuil minimal, la conscience n’est pas une caractéristique qui peut se mesurer comme la température et n’est pas liée à l’intelligence. Il est donc difficile de savoir, par exemple, s’il y a plus de conscience chez un humain que chez un cochon. Ils manifestent simplement deux types différents de conscience. Seth se tourne ensuite vers les contenus de la conscience : les couleurs, les odeurs, les visions, les pensées, etc. Montrant comment ceux-ci sont construits par le cerveau, il défend la théorie selon laquelle ils ne sont que des hallucinations contrôlées ou corrigées en fonction de la situation. On le comprend très bien avec la couleur qui n’est évidemment pas une propriété intrinsèque des objets. Elle est une qualité que notre cerveau génère pour opérer des distinctions utiles dans notre environnement. Il en serait donc de même pour les autres contenus de conscience. Tous seraient des constructions qui servent à l’adaptation des animaux. Cette conception implique que les ordinateurs ou robots pourront difficilement devenir conscients. Enfin, Seth aborde le sentiment d’être soi, d’être une personne, d’être libre, etc. Le résultat qui s’impose est, là encore, que ce sentiment d’identité n’est qu’une hallucination favorisant notre survie. Bien sûr, ces analyses ne nous font pas comprendre exactement ce qu’est la conscience. Mais elles nous aident certainement à mieux saisir d’où elle vient et la façon dont elle procède.
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
344, janvier 2022.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
ou Place
des libraires.