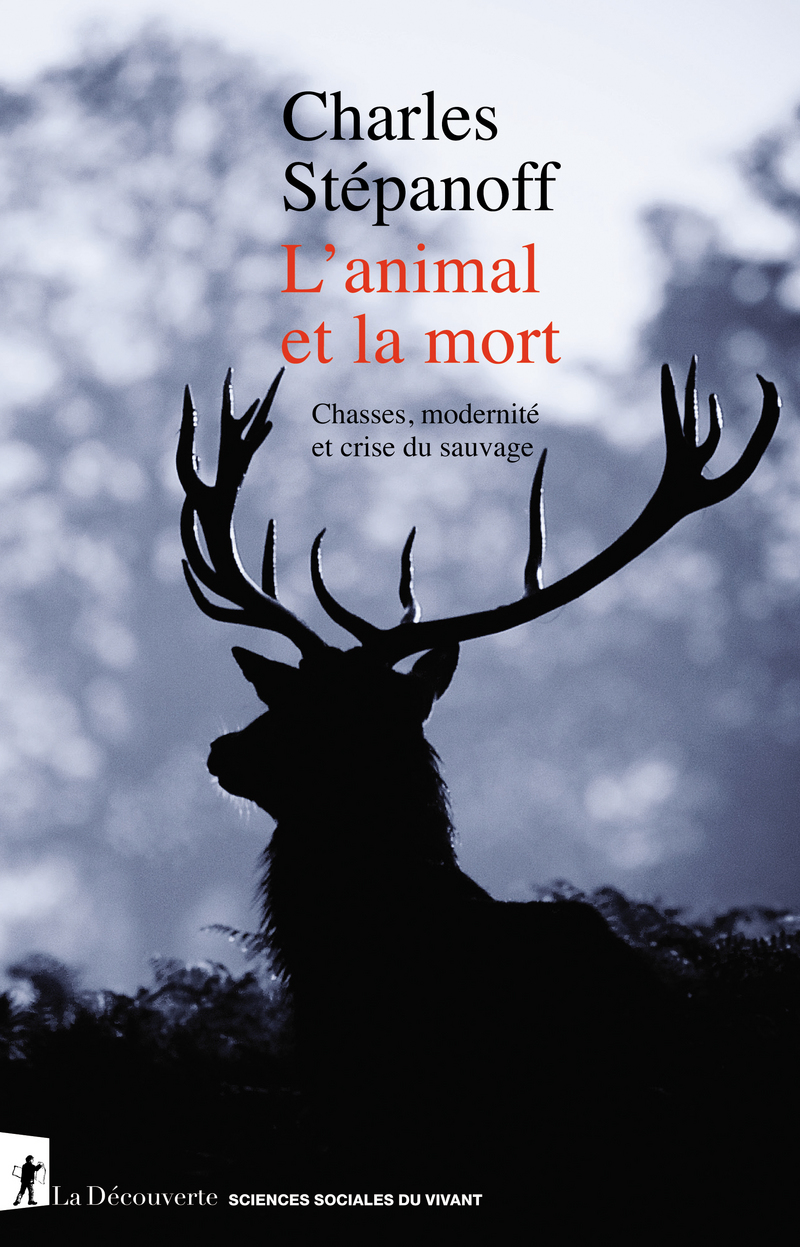L’animal et la mort.
Chasse, modernité et crise du sauvage,
de Charles Stépanoff,
La Découverte, 2021.
Dès l’introduction de ce livre sur la chasse en France, Charles Stépanoff avertit que son but « n’est pas de dire s’il est bien ou mal de chasser » ; il entend simplement « contribuer à une cartographie des positions qui s’affrontent [à propos de la chasse] et à une archéologie de leurs soubassements [p. 17] ». Avec cette volonté de neutralité, l’anthropologue est allé à la rencontre tant des chasseurs que de leurs opposants et nous offre un tableau très riche de cette activité et des débats qu’elle suscite. On y voit à quel point elle a rarement été une activité anodine. Par exemple, Montaigne, connu pour la compassion qu’il exprimait envers les animaux et pour ses dénonciations de la cruauté de la chasse, était en même temps un fervent chasseur. Il reconnaissait même que la chasse lui était plus irrésistible qu’une femme désirée allongée dans son lit ! Si la chasse génère des tensions dans la société, elle en provoque donc aussi chez nombre de chasseurs, tiraillés entre leur respect pour les animaux et le plaisir qu’ils éprouvent dans cette activité où ils les tuent.
Pour bien faire comprendre ce paradoxe, Stépanoff nous présente les efforts que les chasseurs font pour éviter l’effondrement de certaines populations d’animaux sauvages. Il décrit comment une approche rationnelle de la gestion de la faune et de la flore a participé à la disparition de tout un imaginaire paysan de cohabitation durable entre les humains et les animaux. Il montre l’attachement des chasseurs à des bocages qui sont des lieux de vie pour toute une petite faune. Il explique comment le retour des sangliers a bouleversé les chasses traditionnelles au petit gibier et a accentué les divisions entre chasse familiale et chasse de loisir. Cette distinction lui donne l’occasion de rappeler la persistance, dans certaines régions, d’une chasse rurale qu’il faut appréhender à travers un ensemble de productions vivrières : on chasse pour se nourrir et on veille donc à préserver les animaux sauvages qui seront mangés plus tard. Stépanoff va aussi cheminer avec les piégeurs et déterreurs qu’il nous présente comme des régulateurs bienveillants, réalistes devant des conflits inhérents à la cohabitation entre humains et animaux sauvages. Puis Stépanoff montre comment cette chasse paysanne s’est heurtée, surtout après la seconde Guerre mondiale, à une volonté gestionnaire des territoires qui a transformé des animaux sauvages, parfois tués et mangés, mais respectés, en produits marchands. Modernisation qui a d’ailleurs ravivé des tensions, au sein du monde de la chasse, entre élites sociales et paysans à propos de leurs façons différentes d’habiter la terre.
Cette question de la fonction de la chasse conduit l’auteur à évoquer les rituels qui l’accompagnent de nos jours et qui témoignent, selon lui, d’une volonté de marquer un « rapport à l’animal et au sauvage qui n’est fondé ni sur la production gestionnaire (l’exploitation de la nature) ni sur la protection dominatrice (l’amour de la nature), mais sur la circulation de la chair et du sang [p. 158] ». Cette symbolique ne convainc pas tout le monde, toutefois. Stépanoff décrit en effet comment les opposants à la chasse, en particulier la chasse à courre, tentent régulièrement de perturber le travail des veneurs. Deux logiques s’opposent donc. Celle des seconds, qui voient dans la chasse un combat loyal avec une bête sauvage. Celle des premiers, qui estiment que l’on ne doit pas faire de mal à un animal sans nécessité. Autrement dit, là où les veneurs se voient comme partie prenante d’une nature où la prédation a toute sa place, les anti-chasses défendent une attitude empathique fondée sur l’attention à la souffrance de chaque animal. Cela dit, Stépanoff montre que cette tension traverse aussi la conscience des chasseurs : « Partout [sur tous les continents et à travers l’histoire], la mise à mort des animaux et la consommation de leur chair s’environnent de traitements rituels, de compensations, de justifications et de mythes pour que la chasse soit autre chose qu’une dévoration destructrice et cruelle. L’homme vit avec cette contradiction intime qui parfois le déchire : il est un prédateur empathique. [p. 237] » Stépanoff peut alors montrer comment la chasse a été intégrée à des mythes divers pour être légitimée. Comment, par exemple, les rois et seigneurs se sont pendant longtemps attribué le droit exclusif de mise à mort de certains animaux sauvages, comme pour s’approprier la puissance de ces derniers et légitimer ainsi leur propre pouvoir.
Mais ces justifications de la chasse, dont les modalités diffèrent avec les époques, ont aussi souvent laissé place à un sentiment de malaise. Stépanoff rappelle ainsi que le « double danger de la bestialité du chasseur et de l’humanité de la proie, qui parcourt les mythologies et les traditions orales, inspire également, mais sous une configuration profondément différente, les critiques savantes de la chasse formulées depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours [p. 328] ». Il ne manque pas non plus de souligner que ce malaise croît régulièrement depuis environ deux siècles. La raison est bien sûr à chercher du côté de la pacification des mœurs. Notre société accepte de moins en moins la violence ; elle ne s’en accommode que si elle reste cachée. Or le chasseur tue en plein air. Il heurte donc les consciences. Puis, plus fondamentalement, notre société a décrété qu’il n’est pas légal de tuer un animal sans nécessité. La chasse, à l’instar de l’alimentation carnée d’ailleurs, pose donc un problème éthique majeur que les animalistes ne cessent de rappeler. Comme le souligne Stépanoff, ces derniers distinguent en effet « les êtres sensibles, qui ont des intérêts dignes d’être défendus » et « les êtres insensibles, comme les pierres, qui n’en ont pas [p. 332] ». Les animaux appartenant bien sûr à la première catégorie, il est devenu inconcevable pour les animalistes qu’ils soient mis à mort, juste pour un loisir ou pour s’en nourrir. Mais ces appels sont peu entendus dans un monde où les traditions cynégétiques gardent encore une grande force d’attraction.
Pour être fidèle à sa règle de neutralité, Stépanoff ne se range explicitement d’aucun côté. Mais, sans qu’il en ait nécessairement conscience, son propos trahit son orientation. Il a lui-même rappelé que « la mise à mort des animaux et la consommation de leur chair s’environnent […] de justifications et de mythes pour que la chasse soit autre chose qu’une dévoration destructrice et cruelle ». Or, tout au long de son livre, il présente avec empathie ces justifications et ces mythes que lui offre le monde de la chasse. Il donne ainsi un sens à ces mises à mort pour que leur caractère cruel ne transparaisse pas. Puis, il détourne le regard des bêtes blessées, agonisantes et mourantes pour raconter avec sympathie des parcours d’hommes et de femmes, attachés à leur territoire et respectueux de leurs traditions. En somme, il cache la souffrance, le sang et la mort derrière du pittoresque. Enfin, tout à sa tâche d’anthropologue en immersion, il finit par intégrer le discours des chasseurs, comme l’illustre – parmi d’autres – son affirmation que manger « ce que l’on tue et tuer ce que l’on mange, c’est […] garder [la violence] sous contrôle et l’entourer des égards dus à ceux qui nous nourrissent, qui constituent notre chair de leur mort et qui survivent ainsi dans les palpitations de nos corps [sic] ». Ce à quoi il ajoute : « Les chasses terrestres réaffirment une dépendance des humains à l’égard du vivant et une insertion de notre espèce, parmi les autres, dans le cycle infini des prédations [p. 376] ». Mais comment a-t-il pu oublier que les humains n’ont pas besoin de tuer des animaux pour se nourrir et comment peut-il en venir à écrire que les animaux que nous mangeons survivent dans nos entrailles ? De la même manière, Stépanoff n’hésite pas à affirmer que l’anthropologie se doit de rappeler que les chasseurs sont des résistants face au rouleau compresseur de la modernité, avec encore le sous-entendu erroné qu’il nous faudrait, nous autres humains, manger des animaux : « À l’heure où de plus en plus de personnes, notamment dans les jeunes générations, s’interrogent sur la délégation des tâches [caractéristique de la modernité] et souhaitent reprendre en main les conditions de leur survie [sic], il appartient à l’anthropologie d’illustrer la multiplicité des formes de vie résistant à cette alternative : ni protéger le vivant ni l’exploiter, mais en faire un lieu de vie, habiter le vivant et s’en nourrir, dans une relation d’incorporation consubstantielle, qui n’est pas univoque et purifiée mais composite et trouble. [p. 378] ». Dommage qu’il n’ait pas retenu que la modernité nous a aussi invités à nous détourner des vieilles fables sanguinaires et à nous extraire de la violence. Au final, les pro-chasses aimeront beaucoup ce livre qui offre un panorama très riche de leur monde. Mais les anti-chasses ont aussi tout intérêt à s’y plonger dans la mesure où ils en apprendront beaucoup sur les conceptions de leurs opposants. C’est donc un très bon livre. Il faut juste savoir que l’anthropologue qui l’a écrit a été gagné par son sujet d’étude. Heureusement qu’il n’a pas effectué ses recherches auprès des dernières tribus cannibales !
Thomas Lepeltier,
Revue des
Questions Scientifiques, 194 (1-2), 2023.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
ou Place
des libraires.