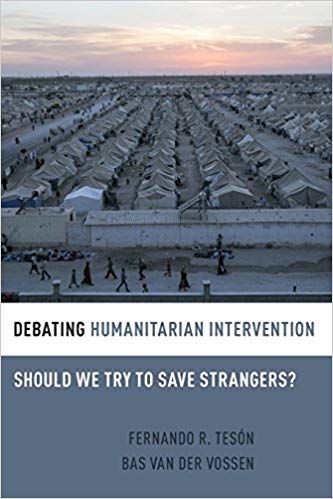Debating Humanitarian Intervention.
Should We Try to Save Strangers ?,
Fernando Tesón & Bas van der Vossen,
Oxford University Press, 2017.
Les interventions militaires en Irak, en Libye et en Syrie de ces dernières années étaient-elles justifiées ? Au-delà de ces exemples, qu’il faudrait évaluer au cas par cas, on peut se demander ce qui permet de justifier une intervention militaire pour des raisons humanitaires, par exemple quand un dictateur sévit cruellement contre son peuple. Même si l’intention est bonne, des innocents risquent d’être tués et le succès de l’opération n’est jamais garanti. Comment donc établir sa légitimité ? La souveraineté des États ne doit-elle pas être un minimum respectée ? Ou bien suffit-il que les chances de renversement du dictateur soient grandes au moment de l’action ? À moins qu’il faille attendre la fin des opérations pour juger de sa légitimité. Sur ces questions, les deux auteurs de ce livre défendent des points de vue divergents. L’ouvrage permet donc de faire un tour relativement complet de cette question complexe.
Les deux auteurs s’entendent pour reconnaître que, pour être légitime, une intervention doit déjà avoir des chances raisonnables de succès, doit être la seule façon de protéger les populations victimes de violences et doit être une réponse proportionnelle à ces dernières. Mais autant le juriste Fernando Tesón estime que ces conditions peuvent être régulièrement satisfaites, autant le philosophe Bas van der Vossen considère que c’est très rarement le cas. Un premier désaccord provient donc d’une divergence d’appréciation des interventions historiques. Quand le premier auteur avance que certaines ont permis d’éviter le pire et qu’il est donc envisageable que ce soit encore le cas, le second considère qu’elles ont entrainé une détérioration de situations déjà problématiques et qu’il y peu de raison de penser que les prochaines interventions aient plus de succès, sauf situation exceptionnelle. Ensuite, là où Tesón estime que seuls les droits des individus sont à protéger, Van der Vossen pense qu’il faut aussi prendre en considération l’idée d’auto-détermination ou de souveraineté. Concrètement, cela veut dire que, dans le premier cas, on intervient en ne pensant qu’aux individus menacés alors que, dans le deuxième, on agit en aidant des populations à prendre elles-mêmes leur destin en main.
Un autre point de désaccord concerne le timing de l’évaluation. Van
der Vossen estime que, pour être légitime, une intervention
humanitaire doit présenter de très fortes garanties de succès avant
d’être lancée (ce qui, à ses yeux, est très rarement le cas). Tesón
n’est bien sûr pas contre cette sage précaution, mais pense que, au
final, c’est le résultat qui compte. Enfin, pour donner un dernier
exemple des désaccords, les auteurs ne s’entendent pas sur la question
de la légalité : une intervention non autorisée par une instance
internationale comme l’Onu peut-elle être justifiée ? Oui, répond
Tesón : il faut parfois passer outre l’autorisation légale pour
éviter des catastrophes humanitaires. Toujours plus sceptique, Van der
Vossen estime au contraire que l’autorisation est fondamentale :
pour s’assurer que les interventions ne soient effectuées que de
manière exceptionnelle et que les garanties de succès soient très
fortes, une autorisation de la communauté internationale est
indispensable.
Bref, aucune position claire, qu’il n’y aurait plus qu’à adopter, ne se dégage de cet ouvrage. Mais ce n’était pas son objectif. En confrontant deux perspectives, ce dernier était de fournir à chaque lecteur les moyens de formuler son propre jugement éclairé. Sur ce plan, mission accomplie…
Thomas Lepeltier,
Sciences Humaines,
310, janvier 2019.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr