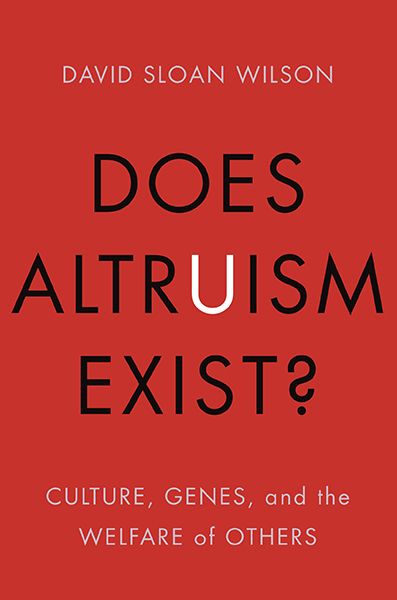Does Altruism Exist ?
Culture, Genes, and the Welfare of Others,
de David Sloan Wilson,
Yale University Press, 2015.
L’altruisme peut être considéré comme une énigme. D’un point de vue évolutionniste, comment expliquer qu’un individu aide les autres à ses dépens. La sélection naturelle ne devrait-elle pas éliminer les individus enclins à des comportements qui semblent désavantageux à leur succès reproductif ? Charles Darwin était conscient de la difficulté et suggéra quelques plausibles solutions. Mais ce n’est qu’au vingtième siècle que l’altruisme devint l’objet de débats animés chez les biologistes. En supposant que la sélection s’opère sur les gènes et rien d’autres, certains chercheurs firent de l’égoïsme le moteur de comportements apparemment altruistes. Par exemple, quand une fourmi se sacrifie pour défendre sa fourmilière, elle ne le ferait pas pour protéger ses consœurs, mais pour assurer la propagation de ses propres gènes. L’altruisme n’existerait donc pas vraiment. C’est ce qu’on appelle la thèse du « gène égoïste », popularisée dans les années 1970 par Richard Dawkins.
Pour David Sloan Wilson, cette conception n’est pas satisfaisante. Ce biologiste est depuis des années un des partisans les plus en vue de la « sélection de groupe », hypothèse longtemps rejetée selon laquelle la pression de sélection ne s’applique pas uniquement au niveau des gènes ou des individus, mais également au niveau des groupes d’individus (d’où son autre nom de « sélection à niveau multiple »). Or cette hypothèse permet de redonner du sens à l’altruisme. Il est en effet possible de montrer que les groupes qui contiennent davantage d’individus altruistes fonctionnent mieux que ceux qui en comptent moins. Par exemple, un groupe dont les membres s’entraident sans en attendre de contrepartie aura plus de succès qu’un groupe où chacun ne pense qu’à son intérêt. Certes, la sélection favorise les plus égoïstes au sein d’un groupe (puisqu’ils peuvent tirer profit de ceux qui le sont moins), mais en même temps elle favorise les groupes qui contiennent le plus d’altruistes. Du coup, en opérant sur des groupes, et pas seulement sur des individus au sein des groupes, la sélection naturelle peut favoriser le développement de comportements altruistes.
Montrer que la « sélection de groupe » permet de rendre compte de l’altruisme n’est toutefois pas le seul objectif de l’auteur. Comme il l’étaye dans la seconde partie de son livre, elle aiderait aussi à repenser les religions, l’économie et les institutions sociales. Concernant les premières, Wilson reprend les analyses d’un précédent ouvrage (Darwin’s Cathedral. Evolution, Religion, and the Nature of Society, 2002), dans lequel il avançait que les religions, même si leurs propositions prises à la lettre sont fausses, seraient des adaptations culturelles qui renforcent la cohésion des société. Concernant l’économie, Wilson pourfend la thèse libérale qui stipule que la seule recherche de l’intérêt personnel est profitable à la société. Fort de sa réhabilitation de l’altruisme comme phénomène biologique et culturel, il soutient en effet qu’une société est d’autant plus performante que ses individus œuvrent au bien commun. Enfin, prolongeant des réflexions qu’il avait déjà présentées là encore dans un précédent ouvrage (The Neighborhood Project. Using evolution to improve my city, 2011), il montre comment toute organisation qui favorise l’expression de l’altruisme améliore le fonctionnement des villes. Au final, voilà un ouvrage qui réussit parfaitement à présenter la notion controversée de « sélection de groupe » et ses possibles applications à des phénomènes sociaux et culturels.
Thomas Lepeltier, Sciences Humaines, 272, juillet 2015.
Pour acheter ce livre : Amazon.fr
Autre livre à signaler :
— Donald W. Pfaff, The
Altruistic Brain. How we are naturally good, Oxford
University Press, 2015.